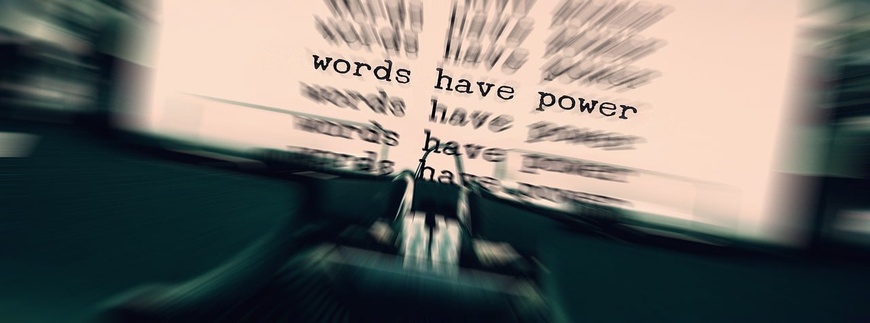Une génération informée, mais prudente
Les jeunes d’aujourd’hui ne manquent pas d’informations. Ils voient, lisent, partagent et commentent. Pourtant, beaucoup choisissent de ne pas s’engager ouvertement, par crainte des conséquences : répression, moqueries ou rejet social.
Rachid, 24 ans, étudiant à N’Djamena, témoigne : « On voit les injustices tous les jours, mais parler, c’est risqué. Même sur Facebook, si tu écris quelque chose de sensible, tu peux avoir des problèmes. Alors, la plupart préfèrent se taire. »
La peur de se faire remarquer ou de se mettre en danger pousse beaucoup à adopter un silence stratégique — une forme d’autoprotection dans un contexte parfois hostile.
L’indifférence née de la fatigue
Au-delà de la peur, certains jeunes avouent simplement ne plus y croire. Après avoir vu des promesses non tenues, des mouvements étouffés et des changements bloqués, ils se sentent impuissants.
Amina, 27 ans, diplômée sans emploi, confie : « J’ai participé à des campagnes de sensibilisation, j’ai écrit, j’ai parlé… mais rien ne change. Alors j’ai arrêté. Parfois, on se fatigue de se battre dans le vide. »
Cette fatigue morale nourrit une indifférence apparente : ce n’est pas qu’ils s’en moquent, mais qu’ils ne savent plus comment agir efficacement.
L’illusion d’engagement sur les réseaux sociaux
Les plateformes comme Facebook, X (Twitter) ou TikTok semblent offrir aux jeunes un espace d’expression. Mais souvent, cette liberté reste superficielle : beaucoup se limitent à partager, liker ou commenter, sans aller plus loin.
Fatimé, 25 ans, explique : « C’est plus facile de poster un message que d’aller sur le terrain. Mais au fond, ça ne change pas grand-chose. On parle beaucoup, mais on agit peu. »
Les réseaux sociaux créent ainsi une illusion d’engagement : on se croit acteur du changement, alors qu’on reste souvent spectateur derrière un écran.
Le besoin d’un nouveau courage collectif
Pour que les choses changent, il ne suffit pas de parler : il faut oser, ensemble. Les jeunes ont le nombre, l’énergie et la créativité nécessaires pour dénoncer les injustices, proposer des idées et bâtir des alternatives. Mais pour cela, il faut réapprendre à croire en sa voix, à se soutenir mutuellement, et à transformer la peur en courage collectif.
Le silence des jeunes face aux injustices n’est pas toujours de l’indifférence. Il est souvent le fruit de la peur, du désenchantement ou du manque d’espaces sûrs pour s’exprimer. Mais le véritable changement commence toujours par une parole, un geste, un refus du silence.
Comme le disait Desmond Tutu : « Rester neutre face à l’injustice, c’est choisir le camp de l’oppresseur. »
Les jeunes d’aujourd’hui ne manquent pas d’informations. Ils voient, lisent, partagent et commentent. Pourtant, beaucoup choisissent de ne pas s’engager ouvertement, par crainte des conséquences : répression, moqueries ou rejet social.
Rachid, 24 ans, étudiant à N’Djamena, témoigne : « On voit les injustices tous les jours, mais parler, c’est risqué. Même sur Facebook, si tu écris quelque chose de sensible, tu peux avoir des problèmes. Alors, la plupart préfèrent se taire. »
La peur de se faire remarquer ou de se mettre en danger pousse beaucoup à adopter un silence stratégique — une forme d’autoprotection dans un contexte parfois hostile.
L’indifférence née de la fatigue
Au-delà de la peur, certains jeunes avouent simplement ne plus y croire. Après avoir vu des promesses non tenues, des mouvements étouffés et des changements bloqués, ils se sentent impuissants.
Amina, 27 ans, diplômée sans emploi, confie : « J’ai participé à des campagnes de sensibilisation, j’ai écrit, j’ai parlé… mais rien ne change. Alors j’ai arrêté. Parfois, on se fatigue de se battre dans le vide. »
Cette fatigue morale nourrit une indifférence apparente : ce n’est pas qu’ils s’en moquent, mais qu’ils ne savent plus comment agir efficacement.
L’illusion d’engagement sur les réseaux sociaux
Les plateformes comme Facebook, X (Twitter) ou TikTok semblent offrir aux jeunes un espace d’expression. Mais souvent, cette liberté reste superficielle : beaucoup se limitent à partager, liker ou commenter, sans aller plus loin.
Fatimé, 25 ans, explique : « C’est plus facile de poster un message que d’aller sur le terrain. Mais au fond, ça ne change pas grand-chose. On parle beaucoup, mais on agit peu. »
Les réseaux sociaux créent ainsi une illusion d’engagement : on se croit acteur du changement, alors qu’on reste souvent spectateur derrière un écran.
Le besoin d’un nouveau courage collectif
Pour que les choses changent, il ne suffit pas de parler : il faut oser, ensemble. Les jeunes ont le nombre, l’énergie et la créativité nécessaires pour dénoncer les injustices, proposer des idées et bâtir des alternatives. Mais pour cela, il faut réapprendre à croire en sa voix, à se soutenir mutuellement, et à transformer la peur en courage collectif.
Le silence des jeunes face aux injustices n’est pas toujours de l’indifférence. Il est souvent le fruit de la peur, du désenchantement ou du manque d’espaces sûrs pour s’exprimer. Mais le véritable changement commence toujours par une parole, un geste, un refus du silence.
Comme le disait Desmond Tutu : « Rester neutre face à l’injustice, c’est choisir le camp de l’oppresseur. »
 Menu
Menu
 Silence générationnel : pourquoi les jeunes du Tchad n’osent plus parler
Silence générationnel : pourquoi les jeunes du Tchad n’osent plus parler